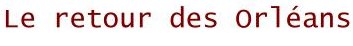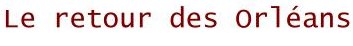|
|
Louis-Philippe à Saint Cloud.
"On lui propose de fixer son habitation à Saint Cloud pendant
l'été et quoiqu'il ait autant d'aversion pour l'une
[les Tuileries] que pour l'autre de ces deux résidences
royales, je crois qu'il se décidera à passer queques
semaines à Saint Cloud" (Journal de Fontaine,
29 avril 1831). A lire Fontaine, il semble que
Louis-Philippe a mis quelque temps à apprécier le château
de ses ancêtres, auquel il préfère nettement sa résidence
privée de Neuilly. Eprouvant de la répugnance "à se mettre
à la place et dans les lieux naguère occuppés par Charles X",
il trouve à redire à la distribution du château "dans lequel
il a cherché, sans succès satisfaisant, à retrouver des
souvenirs de famille".
|
|
|
 |
|
|
Une période de grands travaux.
Néanmoins, la monarchie de Juillet correspond pour Saint Cloud
à de grands travaux de réfection. Ils concernent la Grande
Cascade (1835), les décors du château - la galerie d'Apollon est
redorée et les peintures de Mignard sont restaurées -, les anciens
appartements du roi de Rome. Des changements interviennent
également dans la décoration, dus au goût personnel de
Louis-Philippe. Les salons reçoivent de nouveaux tableaux,
en majorité modernes. Dans les grands salons de réception,
les riches soieries de Lyon que Napoléon avait fait tendre
sont remplacées par la tenture de l'Histoire de Marie de
Médicis, tissée aux Gobelins d'après les tableaux de
Pierre Paul Rubens et destinée à l'origine à Versailles.
Les guides du temps mentionnent dans ces mêmes pièces
des peintures de Coypel et de Fraçois Lemoyne,
probablement encastrées par ordre de Louis-Philippe
afin de "raccorder leur plafond avec ceux de Mignard".
A Nicolas Loir est attribuée la peinture du plafond
du salon de l'Aurore, représentant le Lever de l'Aurore;
A Jean Alaux, le nouveau décor mythologique qui orne le
salon de Mercure. Louis-Philippe est également à l'origine
de la nouvelle bibliothèque éclairée par une verrière et qui
communique d'un côté avec les pièces de réception, de
l'autre avec les appartements sur l'Orangerie : en 1846,
elle renferme prés de 12 000 volumes.
Dans le parc, la nouveauté essentielle est la construction,
à partir de 1836, de la ligne de chemin de fer reliant
Paris à Versailles.
|
|